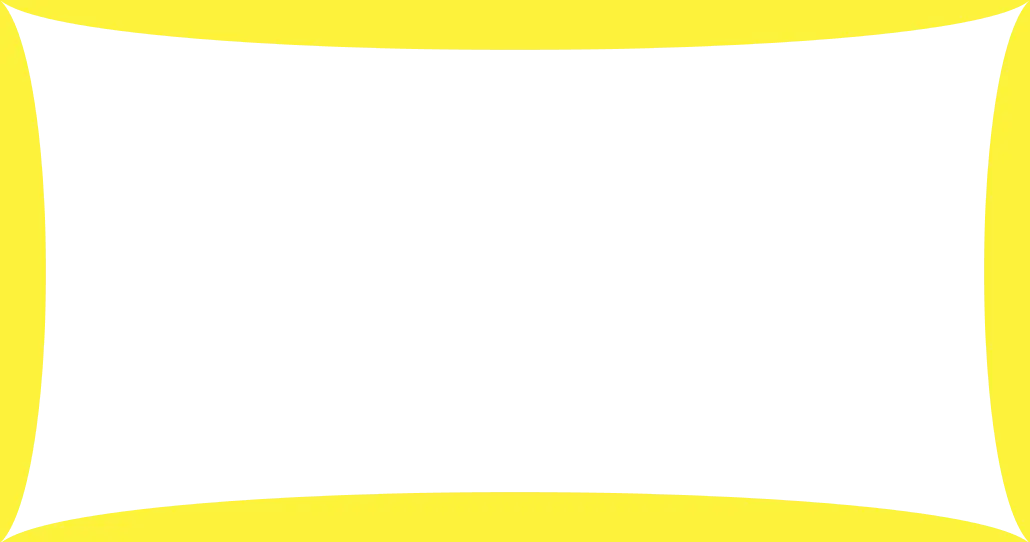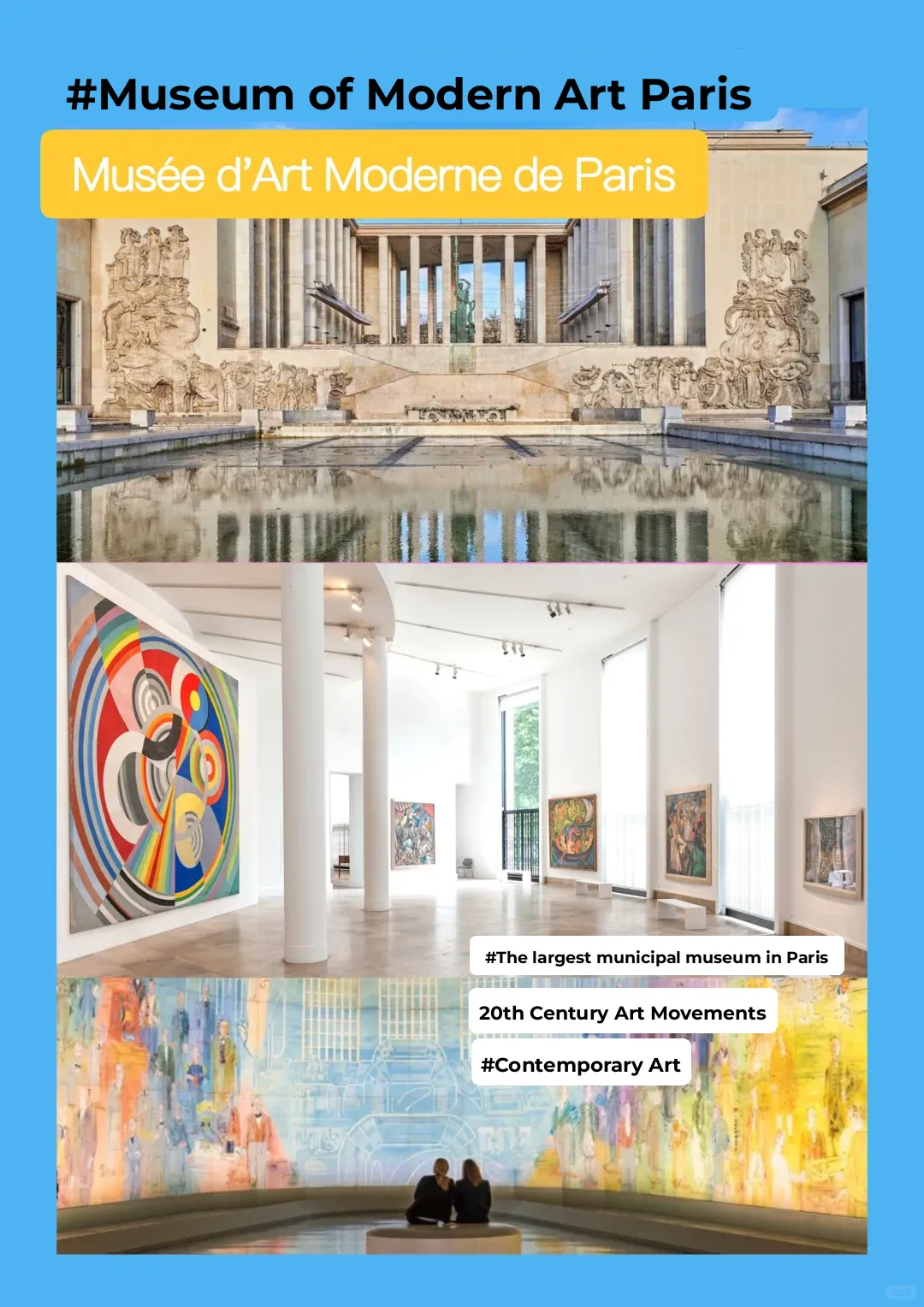Maison de Balzac things to do, attractions, restaurants, events info and trip planning

Basic Info
Maison de Balzac
47 Rue Raynouard, 75016 Paris, France
4.3(918)
Open until 6:00 PM



tickets
Save
spot
spot
Ratings & Description
Info
The Maison de Balzac is a writer's house museum in the former residence of French novelist Honoré de Balzac. It is located in the 16th arrondissement at 47, rue Raynouard, Paris, France, and open daily except Mondays and holidays; admission to the house is free, but a fee is charged for its temporary exhibitions.
Cultural
Accessibility
Family friendly
attractions: Église Notre-Dame-de-Grâce-de-Passy, Passy Park, Théâtre du Ranelagh, Statue of Liberty, Pont Birk, Les Péniches de Paris, Pont de Grenelle, House of Culture of Japan in Paris, La France Renaissante, Clemenceau Museum, restaurants: Rose Bakery Maison Balzac, HSP La Table - Huîtres et Saumons de Passy, Trattoria en Seine, Le Bistrot des Vignes, Le Tournesol 16e, Pizzeria La Matta, Iza by Kura, Langousta, Camille - Passy, Peniche Le Diamant Bleu, local businesses: Philippe Conticini, Passy Plaza, La Croisière Gourmande du Diamant Bleu, Le Chocolat Alain Ducasse, Le Comptoir de l'Annonciation, Zara, Le Petit Appartement & Conciergerie Sézane, SEPHORA PARIS PASSY, REPETTO, Avenue du Président Kennedy - Maison de Radio France, Le Diamant Bleu
 Learn more insights from Wanderboat AI.
Learn more insights from Wanderboat AI.Phone
+33 1 55 74 41 80
Website
maisondebalzac.paris.fr
Open hoursSee all hours
Thu10 AM - 6 PMOpen
Plan your stay

Pet-friendly Hotels in Paris
Find a cozy hotel nearby and make it a full experience.

Affordable Hotels in Paris
Find a cozy hotel nearby and make it a full experience.

The Coolest Hotels You Haven't Heard Of (Yet)
Find a cozy hotel nearby and make it a full experience.

Trending Stays Worth the Hype in Paris
Find a cozy hotel nearby and make it a full experience.
Reviews
Live events

Dinner Cruise in the Heart of Paris with Music
Sat, Feb 28 • 8:30 PM
Port de la Bourdonnais 75007, Paris, France
View details

Expo Street art Paris - Zoo Art Show
Thu, Feb 26 • 11:30 AM
92800 Puteaux, France, 92800
View details

La Cité Immersive des Fables
Thu, Feb 26 • 12:15 PM
5 rue de Berri, Paris 8e, 75008
View details
Nearby attractions of Maison de Balzac
Église Notre-Dame-de-Grâce-de-Passy
Passy Park
Théâtre du Ranelagh
Statue of Liberty
Pont Birk
Les Péniches de Paris
Pont de Grenelle
House of Culture of Japan in Paris
La France Renaissante
Clemenceau Museum

Église Notre-Dame-de-Grâce-de-Passy
4.5
(160)
Closed
Click for details

Passy Park
4.6
(350)
Open until 5:00 PM
Click for details

Théâtre du Ranelagh
4.6
(693)
Open 24 hours
Click for details

Statue of Liberty
4.5
(2.7K)
Open until 12:00 AM
Click for details
Nearby restaurants of Maison de Balzac
Rose Bakery Maison Balzac
HSP La Table - Huîtres et Saumons de Passy
Trattoria en Seine
Le Bistrot des Vignes
Le Tournesol 16e
Pizzeria La Matta
Iza by Kura
Langousta
Camille - Passy
Peniche Le Diamant Bleu

Rose Bakery Maison Balzac
4.3
(118)
Open until 5:30 PM
Click for details

HSP La Table - Huîtres et Saumons de Passy
4.8
(276)
$$
Open until 2:30 PM
Click for details

Trattoria en Seine
4.8
(2.4K)
Closed
Click for details

Le Bistrot des Vignes
4.5
(279)
$$
Open until 2:30 PM
Click for details
Nearby local services of Maison de Balzac
Philippe Conticini
Passy Plaza
La Croisière Gourmande du Diamant Bleu
Le Chocolat Alain Ducasse, Le Comptoir de l'Annonciation
Zara
Le Petit Appartement & Conciergerie Sézane
SEPHORA PARIS PASSY
REPETTO
Avenue du Président Kennedy - Maison de Radio France
Le Diamant Bleu

Philippe Conticini
4.1
(474)
Click for details

Passy Plaza
4.2
(296)
Click for details

La Croisière Gourmande du Diamant Bleu
4.8
(2.1K)
Click for details

Le Chocolat Alain Ducasse, Le Comptoir de l'Annonciation
5.0
(67)
Click for details